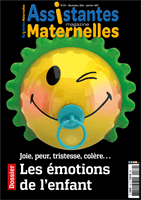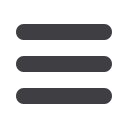numéro 139 - décembre 2016 - janvier 2017
39
Diététique
développement
enfant
bébé
émotions
affectif
méthodes
développement
enfant
réfléxion
imitation
connaissances
câlins
théories
affectivité
pédagogue
accompagnement
apprentissages
assistantes maternelles
attachement
compétences
observations
trum couvre les besoins du nouveau-né pour les
quarante-huit à soixante-douze heures après la
naissance avant d’évoluer en lait maternel avec
la montée de lait.
Le lait maternel est composé majoritairement
d’eau (87,5 %), de glucides (7 %), de lipides (4 %), de
protides (1 %), ainsi que de vitamines, minéraux
et oligoéléments. Sa composition évolue en fonc-
tion des besoins de l’enfant et de sa croissance.
Les lipides
La teneur en lipides du lait maternel varie en
fonction des moments de la journée (de trois à
cent quatre-vingt grammes par litre) et de l’âge
de l’enfant. Au début de la tétée, le lait est riche
en eau et en glucide (sucre). Au cours de la tétée,
le lait s’enrichit en protéines et en graisse. Cet
apport nutritionnel va réguler les besoins nutri-
tionnels du nouveau-né et sa satiété. En raison du
temps de métabolisation, la présence de lipides
se concentre en fin de tétée. Ces lipides corres-
pondent à des triglycérides, du cholestérol et des
acides gras polyinsaturés. Le cholestérol est un
vecteur hormonal. Les graisses citées servent à
la constitution du système nerveux central de
l’enfant. Les acides gras polyinsaturés sont en
partie des acides gras essentiels. Ils ne peuvent
être apportés que par l’alimentation et véhiculés
par la composition nutritionnelle des repas de la
mère.
Les protides
La teneur en protéines du lait maternel est
inférieure aux autres mammifères, mais ces
protéines sont plus facilement absor-
bées du fait de leur parfaite adéquation
avec les besoins de l’enfant. Le lait
maternel contient trois fois moins de
protéines que le lait de vache. Les pro-
téines du lait maternel sont consti-
tuées du lactosérum, de la caséine et
d’immunoglobuline.
Le lactosérum contient de l’eau et
des protéines solubles : l’alphalac-
talbumine et la lactoferrine. L’al-
phalactalbumine, génératrice de
lactose, est nécessaire au développe-
ment du cerveau du bébé. La lacto-
ferrine est une protéine qui va per-
mettre l’absorption du fer. C’est aussi
un agent anti-infectieux.
La caséine du lait maternel est
pour moitié moins représentée
que dans le lait de vache. L’atout
de ces caséines est la formation
de micelles plus petites que celles du
lait de vache. Les caséines vont se regrouper en
petits amas moléculaires et rester en suspension
dans le lait maternel. De par leur petite taille, elles
seront plus facilement assimilables par l’appareil
digestif du nouveau-né. Ces protéines vont être
utilisées pour renforcer l’immunité de l’enfant.
Les immunoglobulines sont des anticorps qui
ont un rôle de défense de notre corps contre les
agressions extérieures. Leur rôle est d’attaquer et
de détruire les micro-organismes des maladies
infectieuses.
En comparaison, le lait de vache contient une
plus grande quantité de protéines avec une pro-
portion plus importante de protéines insolubles
que de protéines solubles. Dans le lait de vache,
les protéines présentes sont plus allergisantes,
avec une moindre tolérance digestive comparée
à celle du lait maternel.
Les glucides
Le lait maternel est riche en oligosaccharides et
facilite la croissance et l’ensemencement bacté-
rien du colon du nouveau-né. La teneur en oligo-
saccharide du lait maternel en fait une compo-
sition rare. Il existe plus de cent espèces d’oligo-
saccharides différents dans le lait maternel qui
vont ensemencer la flore intestinale au niveau
du colon.
Le tube digestif du nouveau-né est stérile à la
naissance. La muqueuse digestive du bébé est
immature et met quatre mois à se constituer.
L’allaitement permet une colonisation bac-
térienne et microbienne adaptée. Il favo-
rise la maturation intestinale, la mise en
place de la réponse immunitaire et
le développement d’un environne-
ment microbien sain pour l’enfant
3
.
La flore intestinale va s’enrichir
de bactéries et établir son équi-
libre entre les différentes souches
bactériennes. Les bactéries nous
aident à la digestion et à la trans-
formation des nutriments. Elles
synthétisent des enzymes (pro-
téines qui vont servir dans l’ac-
tivation de réaction chimique),
des vitamines et transforment
les nutriments. Elles nous pro-
tègent des bactéries porteuses
de maladies. L’interaction entre
la flore intestinale et l’obésité se
montre de nos jours de plus en
plus importante
4
. En effet, les
personnes souffrant d’obésité
ont une flore bactérienne plus
pauvre en espèce de micro-orga-