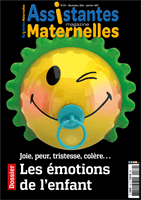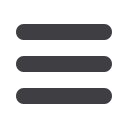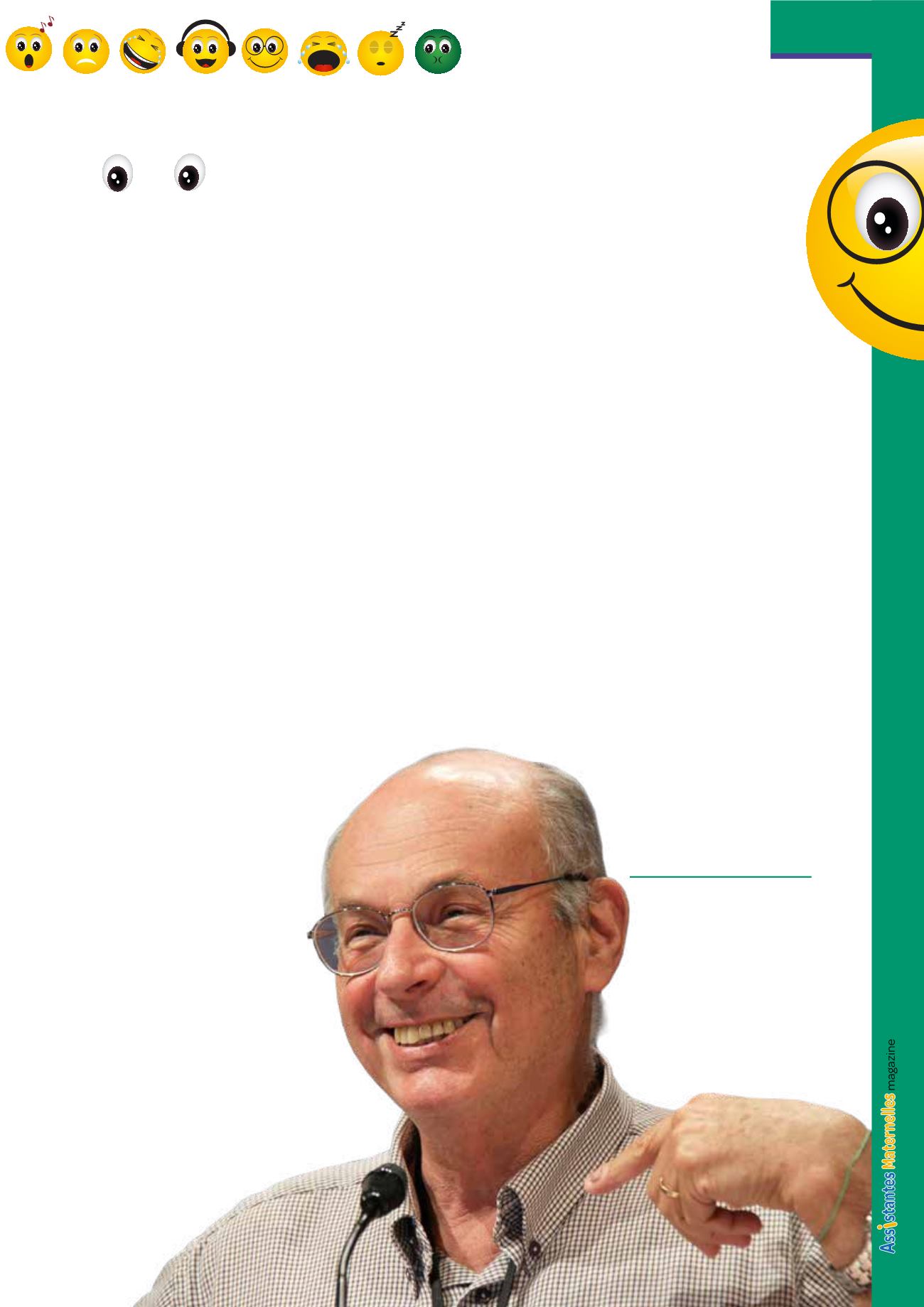
émotions, existence
Savoir-faire
Pour comprendre
13
émotions associées aux images et aux mots qui sont
dans ma mémoire.
« Un soldat en uniforme noir est venu s’asseoir près de
moi. Il m’a montré la photo d’un petit garçon de mon âge,
son fils probablement. […] Pourquoi ai-je un souvenir si
clair de ce scénario ? Parce que l’étonnement l’a fixé dans
ma mémoire ? […] Pour ne pas vivre dans la peur, avais-je
besoin de penser qu’il y a des traces d’humanité même
chez les persécuteurs ? »
Les émotions, le ressenti ou la représentation d’un
événement sont-ils modelés par nos valeurs, notam-
ment notre foi en l’humanité ?
Je pense que j’avais besoin de cette ambivalence, que
j’avais besoin de penser qu’il y avait de l’humanité
même chez les persécuteurs, sinon j’aurais vécu
dans un monde du « diable et du bon dieu », du bien
et du mal, et j’aurais probablement fait un syndrome
psychotraumatique. Cette ambivalence m’a protégé.
C’est un facteur de protection, ce n’est probablement
pas un facteur de résilience, mais cela m’a protégé.
Je pense que j’avais besoin de cette image et, encore
aujourd’hui, j’ai besoin de penser que même chez
les agresseurs, il y a toujours une part d’humanité :
cela m’a sûrement servi dans mon métier de psy-
chiatre où on m’apprenait – je fais partie de cette
génération –, les théories de la dégénérescence.
Le nazisme avait perdu la guerre des armes,
mais il n’avait pas perdu la guerre des idées,
et ces théories de la dégénérescence me
mettaient très mal à l’aise. J’avais besoin
de cette ambivalence pour me dire, que,
même chez les aliénés il y a une part
d’humanité, même chez les persécu-
teurs, il y a une part de bonté.
« Dans les jours suivants, j’entendais les
adultes parler de “débarquement”. Le halo
affectif, quand ils prononçaient ce mot, me
transmettait une joie légère. Ils disaient gaiement
“La Rochelle”, mais leur visage devenait sombre
quand ils parlaient de “Royan”. Je sentais claire-
ment que certains mots étaient porteurs d’espoirs
et d’autres d’inquiétudes. »
Comment des mots peuvent-ils s’associer à des
émotions ou à des représentations ?
Mary Main, psychologue américaine, peut
répondre à cette question : elle
affirme que, lorsque l’on
raconte un événement
difficile, ce qui compte, c’est la manière d’en parler,
la rhétorique. Elle cite l’exemple de personnes qui
ont des récits difficiles à transmettre à leurs enfants.
Si elles racontent : «
Mon dieu, c’est effrayant, c’est
horrible j’ai été agressé, j’ai été torturé et le monde
est comme cela
», elles transmettent l’horreur. Si au
contraire, elles disent : «
Le monde a été difficile, mais
j’ai réussi à surmonter parce que j’ai trouvé une aide,
que j’ai réussi à comprendre
», en faisant le même
récit, elles ne transmettent pas l’horreur. C’est la rhé-
torique qui transmet l’émotion, la manière de dire qui
transmet l’émotion ; ce n’est pas le fait qui transmet
l’émotion, mais la manière d’en parler.
« On disait que j’étais bavard comme une pie, je racontais des
histoires, j’adressais la parole à des inconnus dans la rue. Qui
aurait pu penser que je parlais pour me taire ? »
Vous utilisiez la parole pour vous protéger : votre
parole disait alors autre chose que ce qu’elle trans-
mettait aux autres ?
Non, ma parole était clivée : quand je parlais, j’étais
totalement sincère et quand je me taisais, j’étais aussi
totalement sincère. Ce que j’avais à dire, je le disais, je
ne cédais pas à un « faux self », mais si je devais me
taire, je me taisais, j’avais un silence que les
gens ne remarquaient pas. Ils inter-
prétaient cela à leur manière. Par
exemple, on me disait : « Tu es
bavard comme une pie » ou
alors on m’appelait le « beau
1 -
Sauve-toi, la vie t’appelle
, paru en
2012 aux éditions Odile Jacob.
2 - Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psy-
chanalyste et éthologue français, est
directeur d’enseignement à Toulon.
Également président de l’Institut
petite enfance, docteur
honoris
causa
de plusieurs universités
étrangères, il est notamment connu
pour avoir développé le concept
de résilience, objet aujourd’hui de
recherches internationales.
numéro 139 - décembre 2016 - janvier 2017